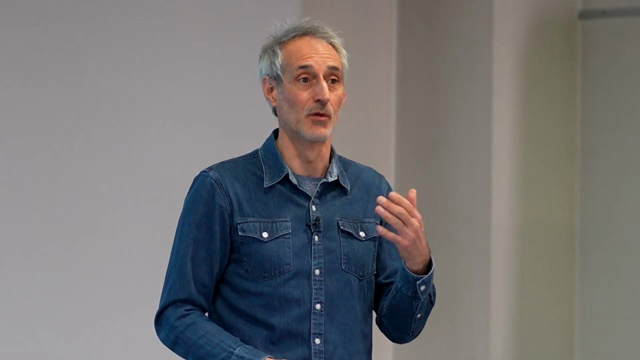A quoi sert la pensée spontanée ? De l'adaptation au dysfonctionnement

Coférence Hub Innov 2025 – Fondatin USMB
―@laurenterrigeolUne pensée qui surgit... sans prévenir
Il nous est tous arrivé de lire plusieurs lignes d’un livre, voire une page entière, sans rien retenir, absorbé·e par des pensées sans lien apparent avec la lecture. Ce phénomène, familier et souvent incontrôlé, relève de ce qu’on appelle la pensée spontanée.
Définie en psychologie comme « un état mental, ou une séquence d'états mentaux, qui survient relativement librement en raison d'une absence de contraintes fortes sur le contenu de chaque état et sur les transitions d'un état mental à un autre » (Christoff et al., 2016), la pensée spontanée se distingue par sa liberté de contenu et sa survenue non intentionnelle. Elle émerge hors du cadre de l’activité ou de l’environnement immédiat, souvent suite à une rupture de l’attention.
Autrement dit, le fil continu de la pensée oscille entre différents états, chacun présentant des caractéristiques propres ; la pensée spontanée est un de ces états.
Un phénomène courant, aux fonctions multiples
Les études estiment que nous passons entre 20 % et 50 % de notre temps éveillé à penser de manière spontanée. Cette fréquence soulève une question essentielle : cette pensée est-elle utile ?
Les recherches récentes montrent que oui. La pensée spontanée remplit plusieurs fonctions adaptatives :
Elle favorise la créativité et l’innovation ;
Elle lutte contre l’ennui en autorisant le vagabondage de l’esprit ;
Elle intervient dans la gestion du cycle attentionnel ;
Elle participe à la planification et l’anticipation du futur ;
Elle joue un rôle dans la régulation émotionnelle ;
Et elle contribue à la consolidation de nos souvenirs.
Alors laisser son esprit « partir ailleurs » peut avoir des effets bénéfiques sur nos capacités cognitives et notre bien-être global.
Quand la pensée spontanée devient dysfonctionnelle
Cependant, cette même pensée peut aussi perturber nos activités du quotidien – lecture, conduite, conversation – même lorsqu’elle reste fonctionnelle. Les choses se compliquent lorsqu’elle devient dysfonctionnelle.
Un exemple bien documenté est celui des pensées répétitives négatives (PRN). Ces pensées sont intrusives, répétitives, difficiles à désengager, et consomment une grande quantité de ressources mentales. Elles surviennent souvent en situation de stress et tendent à amplifier la réponse émotionnelle, contribuant ainsi à l’installation ou l’aggravation de troubles psychiques.
Les PRN sont associées à plusieurs pathologies, notamment :
La dépression ;
Les troubles obsessionnels compulsifs (TOC) ;
Les troubles des conduites alimentaires ;
Le trouble déficitaire de l’attention avec ou sans hyperactivité (TDAH), notamment dans certains contextes d'exécution de tâches.
Il est important de noter que ces associations dépendent de nombreux facteurs : le contenu des pensées, leur dynamique, mais aussi le contexte dans lequel elles émergent.
Conclusion : cultiver le vagabondage... avec vigilance
La pensée spontanée est loin d’être une erreur de fonctionnement du cerveau. Elle est au contraire un mécanisme adaptatif, qui enrichit notre fonctionnement mental. Mais lorsqu’elle échappe à toute régulation, ou qu’elle se fige dans des boucles négatives, elle devient un facteur de risque pour la santé mentale.
Mieux la comprendre, c’est mieux identifier ce qui relève du vagabondage fertile, et ce qui mérite une attention clinique. En ce sens, la pensée spontanée constitue aujourd’hui une cible d’intervention prometteuse pour prévenir l’émergence, le maintien ou l’aggravation de nombreux troubles psychique