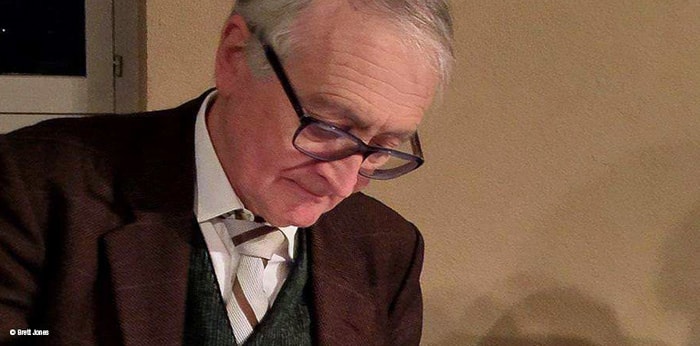La Savoie a compté jusqu'à 10000 ha de vignes aux XVIII-XIXe siècles

Pour une histoire bi-millénaire du vignoble savoyard
Il s’agit d’un des plus vieux vignobles de France après la zone méditerranéenne tôt romanisée. Déjà au 1er siècle après J.-C., Pline l’Ancien (Histoire naturelle) signalait l’existence d’un cépage apprécié à Rome l’allobrogica, sorte de proto-mondeuse dont l’élevage était apprécié à Rome. Mais c’est le développement du réseau ecclésiastique (évêchés et paroisses) et monastique qui donne une impulsion majeure au vignoble alpin à l’époque médiévale, vignoble de forte pente sur substrat morainique et calcaire (Jongieux, Chignin et Arbin). C’est oublier l’œuvre des comtes et ducs de Savoie qui sont à l’origine de nombreux clos, situés sur de bons terroirs, souvent à l’origine des crus actuels (par exemple Ripailles). Un commerce du vin se développe alors sur le Rhône autour de Yenne et Chanaz vers Lyon. Le vin reste cependant avant la fin du Moyen Âge un breuvage consacré au rituel eucharistique et à la noblesse. Mais le développement urbain accroit la consommation d’une clientèle plus large à tel point que la fiscalité qui pèse lourdement sur le commerce du vin a permis la construction des murailles de Chambéry (1377-1378).
Tant et si bien que lorsque la mappe sarde, premier cadastre cartographié, est réalisée à des fins fiscales (1728-1734), on constate que la vigne est implantée partout en Savoie atteignant une superficie proche de 10000 ha. Mais la vigne n’est pas conduite de la même façon qu’aujourd’hui : plantation mêlant les cépages, plus nombreux qu’aujourd’hui, en hautain (ou cosses), dont il reste en Chautagne quelques vestiges, rendements relativement faibles. Le vin s’inscrit dans une polyculture qui permet à la paysannrie de vivre mieux. En termes de surfaces, on peut considérer que le vignoble savoyard atteint son apogée au milieu du XIXe siècle. Notons aussi que jusqu’au développement du chemin de fer, c’est le vin rouge qui est le plus apprécié et largement produit : l’on trouve mondeuse ou persan dans les inventaires des caves des grands ecclésiastiques.
À partir du XIXe siècle, des progrès dans la formation des vignerons se font jour, mais c’est sans compter l’apparition de maladies de la vigne venues des Amériques : l’oïdium, la mildiou et surtout le phylloxéra qui touche les vignes savoyardes à partir de 1879 et jusqu’en 1900. Plus de 11000 ha sont alors détruites. Il faut plusieurs décennies pour le reconstruire et la création de l’INAO et des AOC permet la reconnaissance des crus de Seyssel et Crépy en 1942 et plus généralement des vins de Savoie en 1973, la dernière AOC étant celle du crémant de Savoie en 2015. Les plants américains vont servir de porte greffe et la région, parmi les premières de France, se spécialiser dans le greffage des cépages autochtones pour lutter précisément contre le phylloxéra.
De nos jours, le vignoble compte un peu plus de 2000 ha dont l’essentiel est situé dans le département de la Savoie, car le développement touristique et urbain a fait disparaître le vignoble autour des grands lacs.
Si dans un premier temps, la vigne participe de la polyculture paysanne jusqu’à l’époque contemporaine, elle devient une production à part entière à laquelle se vouent les agriculteurs devenus viticulteurs. De nos jours, le vignoble compte un peu plus de 2000 ha dont l’essentiel est situé dans le département de la Savoie, car le développement touristique et urbain a fait disparaître le vignoble autour des grands lacs. Il ne reste que quelques traces d’un ancien vignoble, alors que les vins blancs, à base de jaquère, altesse ou bergeron, représentent presque les trois-quarts de la production savoyarde. La région reste malgré tout connue pour les cépages anciens et oubliés (mondeuse blanche, gringet et verdesse pour les blancs, persan, douce noire pour les rouges…) qui pourraient jouer un rôle important du fait du réchauffement climatique, qui a, dans un premier temps, favorisé l’essor d’un vignoble de meilleure qualité. Les recherches sur l’ADN des cépages a montré que la syrah que l’on croyait d’origine lointaine est en fait issue du croisement de la mondeuse blanche et du duras, tout comme l’altesse vient des côteaux de Jongieux.
Enfin, le vignoble de Savoie qui produit plus de 110000 hl de vin en moyenne par an ne se contente plus d’étancher la soif des skieurs autour d’une cuisine de terroir, ses vins sont de plus en plus exportés, peuplent les tables des grands restaurants et certaines bouteilles qui ont vieilli à l’ombre de caves bien fraîches n’ont rien à envier en terme de vieillissement aux grands vins régionaux. Que l’on goûte des mondeuses ou des altesses de 1997 !